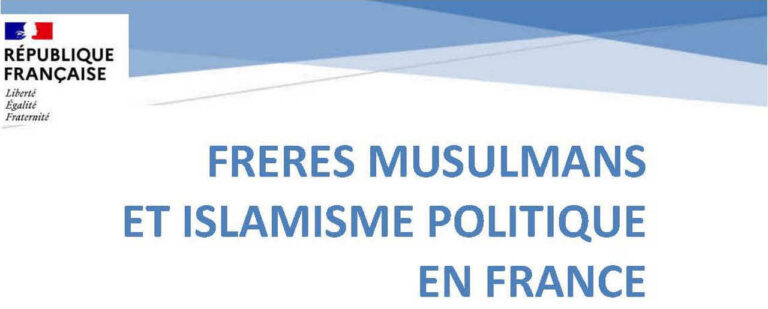Une lecture critique à partir des travaux de François Burgat
Dans la France du XXIe siècle, l’islam ne constitue pas seulement un système de croyances religieuses ; il devient également un objet de problématisation politique, culturelle et historique. Les politiques menées par l’État français, fondées sur le principe de la laïcité, se sont transformées, notamment après le 11 septembre, en un discours sécuritaire visant à exclure l’islam de la sphère publique. Dans ce contexte, le concept de « frérisme », en référence aux Frères musulmans (Ikhwan), s’est imposé comme un nouvel outil de criminalisation. François Burgat analyse les dynamiques historiques et idéologiques sous-jacentes à ce discours et met en lumière un « conflit mémoriel » non résolu dans la France postcoloniale.
Le cadre conceptuel du « Frérisme »
- Le terme « frérisme » ainsi est utilisé de manière péjorative pour désigner des idées, des mouvements ou des individus soupçonnés d’affiliation aux Frères musulmans. Selon Burgat, ce concept :
- Ne relève pas d’une catégorie analytique mais d’un outil d’étiquetage accusatoire ;
- Sert d’instrument politique de lutte contre la diversité idéologique sous couvert de lutte contre le terrorisme ;
- Révèle, aussi, le refus français de reconnaître les musulmans comme sujets politiques autonomes.
L’Ombre de la mémoire coloniale : ce la colonisation à la criminalisation
Le passé colonial de la France en Afrique du Nord (notamment en Algérie, en Tunisie et au Maroc) joue un rôle central dans la compréhension des politiques actuelles à l’égard de l’islam. Burgat affirme que le discours actuel contre le « frérisme » sert à éluder une question fondamentale :
« Les conflits politiques et sociaux issus de la colonisation/décolonisation appartiennent-ils véritablement au passé ? »Sa réponse est catégorique : non.
Les populations musulmanes issues de l’immigration postcoloniale sont marginalisées non seulement sur le plan économique, mais également épistémologique et culturel. Le « frérisme » participe à cette reproduction de l’altérisation.
De la laïcité républicaine à la laïcité sécuritaire
Historiquement, la laïcité française est née comme un contre-pouvoir au catholicisme. Mais au XXIe siècle, ce principe se mue en un outil d’exclusion et d’assimilation dirigé principalement contre les musulmans.
Les accusations de « frérisme » :
- Désignent comme suspects des mosquées, imams, associations, cercles étudiants, etc.
- Justifient des atteintes à la liberté religieuse sous prétexte de protéger la République ;
- Viennent réduire au silence le sujet postcolonial musulman en France.
Comprendre les islamistes, et non les disqualifier : la lecture alternative de François Burgat
Burgat critique l’approche dominante qui analyse les mouvements islamiques uniquement à travers les prismes du radicalisme ou de la sécurité. Il propose une lecture alternative :
- Ces mouvements doivent être compris comme des acteurs politiques modernes, et non archaïques ou rétrogrades ;
- Leurs revendications relèvent souvent de la souveraineté, de la justice et de la représentation, des valeurs universelles ;
- L’Occident préfère diaboliser plutôt que comprendre ces dynamiques islamo-politiques.
Conséquences actuelles : lois, médias et violence bureaucratique
En France, les lois sur la lutte contre le « séparatisme islamiste », les chartes pour les imams, les fermetures d’associations et la surveillance des militants musulmans incarnent les manifestations concrètes de cette ligne idéologique.
Ainsi, le concept de « frérisme » :
- Sert de justification discursive à ces pratiques ;
- Crée une logique de suspicion permanente envers une partie de la population ;
- Alimente un climat où les voix critiques sont réduites au silence dans les sphères médiatiques et intellectuelles.
Conclusion : On ne peut combattre l’islamophobie sans affronter le passé colonial
Par conséquent, les analyses de François Burgat démontrent que les discours anti-musulmans en France ne sont pas de simples réactions contemporaines, mais s’inscrivent dans une continuité historique marquée par un imaginaire colonial. La criminalisation du « frérisme » apparaît ainsi comme un outil de répression du sujet postcolonial et de l’auto-justification de l’État. Son appel est clair :
« Ce n’est pas avec l’islam que la France doit régler ses comptes, mais avec son passé. »Références :
• Burgat, F. (2021). Understanding Political Islam, Hurst & Co.
• Burgat, F. (2023). « La criminalisation du “frérisme” en France : un symptôme post-colonial ».
• Hajjat, A. & Mohammed, M. (2013). Islamophobie : Comment les élites françaises fabriquent le “problème musulman”, La Découverte.
• Sayyid, S. (2014). Recalling the Caliphate: Decolonisation and World Order, Hurst & Co.
* Rapport : « Frères Musulmans et Islam politique en France »
Mushap Reisi